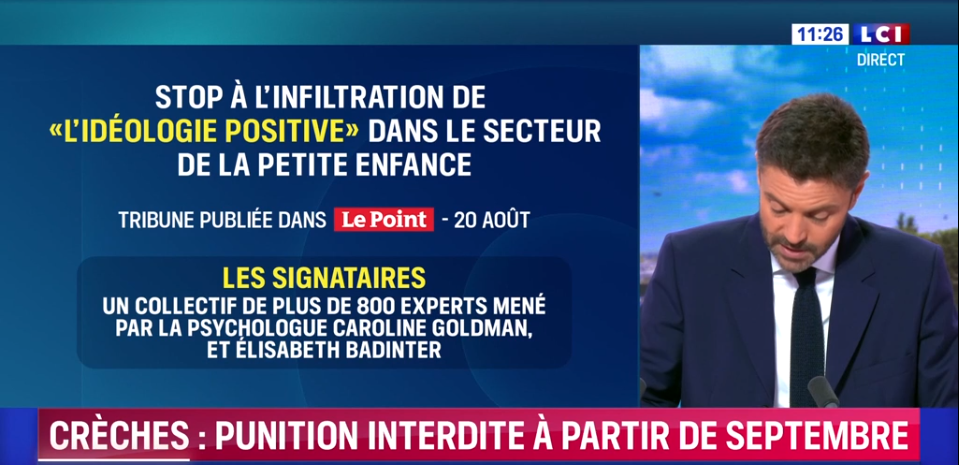Quand la « minorité » disparaît dans la guerre mais réapparaît dans la mort : un autre scandaleux état d’exception
À ceux qui nous demandent d’accepter de perdre nos enfants.
Par Rodolphe Dumouch, membre de l'OVEO
En 1995, Christine Delphy écrivait « L’état d’exception : La dérogation au droit commun comme fondement de la sphère privée1 », dénonçant, pour la première fois, la condition juridique des personnes « mineures2 », exclues des droits humains fondamentaux par le statut que la société leur impose. Toutefois, elle a oublié que cet état d'exception peut entrer, dans la sphère publique, en intersection avec une autre exception : l'état de guerre. À l'époque où elle rédigeait son article, on considérait le spectre d'un conflit éloigné pour toujours, il était donc naturel qu'elle ne l'envisageât pas de ce point de vue.

Le droit français, avec une approche binaire rigide (mais quand même à géométrie variable), refuse de reconnaître des degrés d'autonomie entre la naissance et la « majorité ». Ainsi, même un jour avant votre « majorité », votre signature ne vaut rien. Pas d'exception, rétorquera-t-on sèchement ; pourtant, des exceptions, il y en a au moins deux : aller en prison et faire la guerre. On pourrait ajouter aussi la « majorité sexuelle » qui n'est pas, comme beaucoup le croient naïvement, une reconnaissance d'autonomie dans ce domaine mais juste une moindre protection à partir de 15 ans3. Il en est de même pour les coups et blessures : au-delà de 15 ans, tu es assez fort4 pour être moins protégé et traité comme un « majeur »... Mais si l'on creuse, on trouve d'autres scories plus laides, d'autres pustules sur le visage de Marianne.
Lire la suite