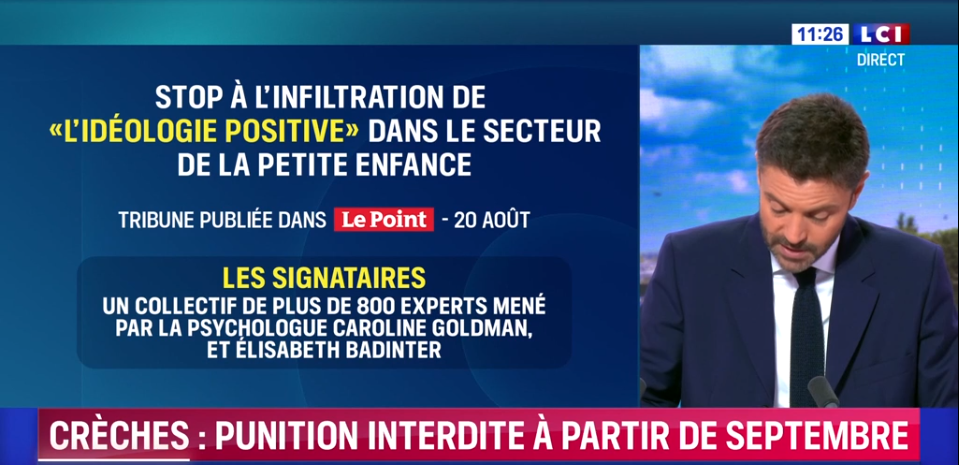Municipales 2026 : place à une politique publique locale à destination des jeunes
Mise à jour 14 février 2026
Nous publions avec le Collectif Enfantiste deux documents que vous trouverez en téléchargement libre ci-dessous, afin d'interpeller les candidat·es de votre commune pour les inciter à ajouter à leur programme des actions en faveur des enfants et adolescent·es.
- Le premier document donne des informations pratiques : compétences des mairies, mode de scrutin, exemple de mail, éléments de réponse à des remarques susceptibles d'être opposées par les candidat·es ou élu·es.
- Le second fichier présente des pistes d'actions regroupées autour de plusieurs axes. Nous vous invitons à sélectionner les idées qui vous semblent pertinentes pour votre territoire afin de les soumettre aux listes candidates de votre commune. Ce pdf peut être joint à votre message si vous décidez de contacter les candidat·es par mail, ou imprimé, pour leur présenter de visu.
N'hésitez pas à vous approprier ces éléments ! Vous pourrez également vous en servir après les élections, et rencontrer la nouvelle équipe municipale pour lui faire part de ces propositions.
- Courrier informatif (pdf de 4 pages, 1 Mo)
- Nos propositions d'actions pour les communes (pdf de 8 pages, 8 Mo)
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales et communautaires (élu·es des intercommunalités). Or, les communes constituent un acteur majeur pour développer une véritable culture du respect des droits et besoins fondamentaux des plus jeunes. En effet, échelon de proximité, les communes et intercommunalités interviennent très concrètement dans leur quotidien (structures d’accueil petite enfance, cantine, périscolaire, sport, culture, espaces publics…, certaines de ces compétences étant parfois transférées à l’échelon intercommunal).
C’est pourquoi l’OVEO a souhaité faire partie des premiers signataires de cette tribune1 appelant à la création d’une délégation dédiée aux droits des enfants dans chaque conseil municipal, quel que soit le nombre d’habitants.
En effet, ce rôle, associé à des moyens humains et financiers, permettrait de mettre en place et de développer une véritable politique publique locale à destination des droits des jeunes personnes.
Chaque citoyen·ne peut signer la tribune sur le site dédié et interpeller les candidat·es en demandant des engagements pour le mandat à venir.
Nous pourrons relayer ici des initiatives permettant d’appuyer cette démarche.
- Une conférence de presse à laquelle nous avons participé s'est tenue mercredi 21 janvier à Bagnolet. Des rencontres territoriales sont prévues prochainement. ↩︎